Comment construire sa base d’endurance cet hiver ?
Construire une bonne base d’endurance, c’est offrir à ton corps les fondations dont il a besoin pour progresser sans fatigue excessive ni blessures. En travaillant à intensité douce pendant plusieurs semaines, ton cœur, tes muscles et ton souffle deviennent plus efficaces et plus économes. Cette solidité acquise en amont te permettra d’aborder tes futurs objectifs avec plus de confiance, de confort… et beaucoup plus de plaisir.

Sommaire
La fin du mois de novembre marque souvent un moment charnière dans l’année sportive : les compétitions se font plus rares, la météo nous invite à lever un peu le pied, et l’envie de repartir sur des bases plus calmes se fait sentir. C’est justement la période idéale pour travailler sa base d’endurance, cette fondation qui permet ensuite d’aborder les mois plus chargés avec plus de confort, d’aisance et de régularité.
Construire son endurance sur plusieurs mois, c’est revenir à l’essentiel : des séances tranquilles, un rythme doux, et le plaisir de retrouver des sensations simples. Que tu pratiques la course à pied ou le triathlon, ce travail “en douceur” est l’un des plus utiles pour progresser durablement, surtout quand on mène une vie déjà bien remplie.
Cet article te guide pas à pas pour comprendre ce qu’est réellement la base d’endurance, pourquoi l’hiver est le moment idéal pour s’y mettre, et comment organiser cette période pour qu’elle soit efficace, motivante et adaptée à ton quotidien
Pourquoi la période hivernale est idéale pour travailler son endurance
Moins de compétitions, plus de temps pour le foncier
Entre fin novembre et le début du printemps, le calendrier sportif se calme nettement. Il y a moins de courses, moins d’événements et moins de moments où l’on se sent « obligée » de performer.
Cette pause naturelle dans l’année permet de sortir du rythme des objectifs, de lever un peu la pression et de retrouver un entraînement plus simple, plus régulier, sans se soucier du chrono.
C’est aussi une période où l’on peut accepter de courir plus lentement, de rallonger un peu les séances tranquilles, et de construire quelque chose de durable. Sans compétition en vue, tu peux vraiment te concentrer sur ton endurance fondamentale : ce travail à basse intensité, souvent négligé, mais pourtant essentiel pour progresser sereinement.
L’hiver : la meilleure saison pour développer les adaptations physiologiques
On l’oublie souvent, mais l’endurance se développe avant tout grâce à la répétition d’efforts doux et réguliers. Et devine quoi ? C’est exactement ce que l’hiver encourage.
Les sorties se font naturellement plus calmes, les allures s’apaisent, et on privilégie souvent des séances continues sans intensité.
Ces conditions sont parfaites pour favoriser toutes les adaptations physiologiques liées à l’endurance :
- un cœur qui pompe plus efficacement,
- des muscles qui utilisent mieux l’énergie,
- une amélioration de la respiration,
- une fatigue générale mieux gérée.
L’avantage, c’est que ces progrès se construisent sans se sentir “à fond”. L’hiver devient ainsi une période stable, propice à la progression douce et régulière, sans pic de fatigue.
Préparer dès maintenant la saison de printemps / été
Même si les beaux jours semblent encore loin, la base d’endurance que tu construis maintenant sera ta meilleure alliée lorsque tu reprendras des entraînements plus structurés et/ou intenses au printemps.
En développant ton foncier pendant l’hiver, tu poses les fondations d’une saison plus fluide : tu récupères mieux, tu tiens plus facilement la distance, tu gères mieux les séances rapides et tu profites davantage de tes sorties.
C’est un peu comme ranger sa maison avant une grosse période : ça demande du calme, du temps et de la constance… mais cela rend tout le reste beaucoup plus simple.
En prenant soin de ton endurance maintenant, tu facilites déjà tes futurs entraînements, sans même y penser.


Qu’est-ce qu’une base d’endurance ?
Définition : l’endurance fondamentale expliquée simplement
La base d’endurance repose sur ce qu’on appelle l’endurance fondamentale : une intensité très douce, à laquelle tu peux courir ou pédaler en respirant calmement, sans être essoufflée.
C’est l’allure où tu te sens en aisance, où tu pourrais discuter sans difficulté, où le mouvement reste confortable et fluide.
En pratique, c’est souvent une intensité plus lente que ce que beaucoup de personnes imaginent. On a parfois l’impression de “ne pas vraiment s’entraîner”, alors que c’est justement à cette allure que le corps fait le plus de progrès à long terme.
Pas besoin de chiffres compliqués : si tu sens que tu pourrais tenir cette allure longtemps, que ta respiration reste stable et que tu récupères vite, tu es dans la bonne zone.
Les bénéfices physiologiques (cœur, VO2, mitochondries, filières énergétiques…)
Travailler en endurance fondamentale n’a rien d’anodin : c’est une zone d’intensité dans laquelle le corps s’adapte énormément, souvent de façon très efficace.
Quelques exemples concrets :
- Le cœur devient plus efficace : il envoie plus de sang à chaque battement, ce qui améliore ta capacité à soutenir un effort sans fatigue.
- Les mitochondries se développent : ce sont elles qui produisent l’énergie. Plus elles sont nombreuses et efficaces, plus l’effort semble facile.
- Le corps apprend à mieux utiliser les graisses comme carburant, ce qui permet d’économiser les réserves de glycogène et d’être plus endurante sur la durée.
- La VO2 et la respiration s’améliorent : tu te sens plus à l’aise, moins essoufflée, même sur les activités du quotidien.
- La récupération devient plus rapide : un corps entraîné en endurance récupère mieux entre les séances… et aussi entre les journées.
Ce sont des bénéfices discrets, mais très puissants. Ils ne se remarquent pas du jour au lendemain, mais s’additionnent semaine après semaine.
Pourquoi bâtir une base solide avant un entraînement spécifique
Lorsque tu entreras dans une période plus dynamique — séance de vitesse, travail au seuil, préparation d’un objectif de printemps — ton corps aura besoin d’appuis solides. Et ces appuis, ce sont précisément les fondations de ton endurance.
Sans base solide :
- les séances rapides deviennent trop exigeantes,
- la fatigue s’accumule vite,
- les risques de blessure augmentent,
- la motivation chute plus facilement.
Avec une base d’endurance stable et régulière :
- tu gères mieux l’intensité,
- tu progresses plus naturellement,
- tu récupères plus vite,
- tu te sens plus confiante dans ta pratique.
Construire une base d’endurance, c’est un peu préparer le terrain avant de planter quelque chose : tu travailles en douceur aujourd’hui pour récolter les bénéfices dans quelques mois, sans brûler les étapes.
Combien de temps faut-il pour construire une base d’endurance ?
Comprendre les cycles d’entraînement : 8–12–16 semaines
La base d’endurance ne se construit pas en quelques sorties : c’est un travail progressif, qui demande du temps pour que le corps s’adapte vraiment.
En général, on parle de cycles de :
- 8 semaines : pour relancer l’endurance après une petite coupure ou pour entretenir un niveau déjà correct.
- 12 semaines : un format très courant, assez long pour créer de vrais changements, assez court pour rester motivée.
- 16 semaines : idéal si tu pars de zéro, si tu reprends après une blessure ou si tu veux reconstruire quelque chose de très solide.
Ces durées ne sont pas des règles rigides, mais des repères. L’idée, c’est de te laisser assez de temps pour progresser en douceur, sans rush et sans fatigue inutile.
Progression réaliste selon ton niveau
La durée de ta période de foncier dépend surtout de ton point de départ et de ce que tu peux faire avec ton emploi du temps.
Voici quelques repères simples :
- Débutante ou reprise après pause : 12 à 16 semaines te donneront un cadre confortable pour retrouver des bases solides sans te presser.
- Pratique régulière mais irrégulière : 8 à 12 semaines permettent de remettre du rythme et de lisser les sensations.
- Sportive déjà endurante : 6 à 8 semaines peuvent suffire pour consolider et repartir sur une préparation spécifique.
L’important n’est pas la durée exacte, mais la cohérence : mieux vaut un cycle un peu plus long, suivi sans stress, qu’un cycle court qui te met la pression.
Les erreurs de durée les plus fréquentes
Quand on commence une période de foncier, certaines erreurs reviennent souvent :
- Vouloir aller trop vite : en pensant qu’un “petit mois” suffit. Or, l’endurance demande du temps et de la patience.
- Allonger le cycle sans structure : faire « du facile » pendant 5 mois sans progression finit par stagner. Il faut un minimum d’évolution.
- Changer trop souvent d’objectif : sauter d’une mini préparation à une autre empêche le corps de vraiment construire quelque chose.
- Sous-estimer la régularité : ce n’est pas la durée totale du cycle qui fait la différence, mais la constance semaine après semaine.
En résumé : choisis une durée réaliste, adaptée à ta vie, et engage-toi à la suivre tranquillement. C’est cette stabilité qui crée les meilleurs progrès.
Comment structurer sa base d’endurance sur plusieurs mois
Définir son volume hebdomadaire de départ
Avant même de penser progression ou intensité, il est essentiel de partir de ce que tu fais déjà. Pas ce que tu “devrais” faire, pas ce que tu vois sur les plans des autres, mais ton volume réel, actuel.
Cela peut être :
- 2 sorties par semaine,
- 3 séances mixtes (course + vélo),
- ou même 1 séance régulière au départ.
On fait avec ce qu’on a, et c’est amplement suffisant. L’objectif de la base d’endurance, ce n’est pas d’augmenter brutalement ta charge d’entraînement : c’est d’ancrer une routine stable, douce et répétée. Une fois ton volume de départ identifié, tu pourras l’ajuster très progressivement, sans stress et sans fatigue excessive.
Le principe des zones d’intensité (FC, RPE, puissance)
Pour travailler en endurance fondamentale, il est important de comprendre dans quelle zone d’intensité tu te situes.
Tu peux t’aider de plusieurs repères simples :
- La fréquence cardiaque (FC) : l’endurance fondamentale se situe généralement entre 65 et 75 % de ta FC maximale.
- Le RPE (perception de l’effort) : une échelle de ressenti de 1 à 10. En endurance, on reste autour de 3 à 4/10.
- La puissance (vélo, capteurs) : si tu pratiques le vélo avec capteur de puissance, l’endurance se situe autour de 55 à 75 % de ta FTP.
Tu n’as pas besoin d’utiliser les trois. Un seul repère suffit.
Et si tu n’aimes pas la technique, le test le plus simple reste la parole : si tu peux parler en phrases complètes, tu es dans la bonne zone.
Cette intensité peut sembler “trop facile” au début, mais c’est précisément là que la magie opère.
Le ratio idéal : 80/20 ou 90/10 (faible intensité vs haute intensité)
Pour construire une base solide, la grande majorité de tes séances doivent rester en intensité faible.
On parle souvent de ratios :
80 % allure facile / 20 % intensité modérée ou soutenue,
ou
90 % allure facile / 10 % un peu plus dynamique pendant l’hiver.
Les deux fonctionnent très bien, surtout si tu pratiques sans objectif de performance. En période de foncier, le ratio 90/10 est souvent le plus doux et le plus efficace pour progresser en évitant la fatigue.
Concrètement, cela signifie que si tu fais 3 séances par semaine :
- 2 séances seront très faciles,
- 1 séance pourra inclure un peu de tempo, quelques côtes douces, ou simplement une allure légèrement plus soutenue… si tu en as envie.
L’objectif est simple : accumuler du temps en zone facile, sans te mettre dans le rouge, sans forcer, sans chercher la performance. C’est ce volume tranquille qui construit une vraie endurance.
Exemple de progression sur 3 mois (novembre → février)
Cette période hivernale de trois mois est parfaite pour installer un rythme doux, régulier, sans pression. L’idée n’est pas de suivre un plan strict, mais d’avoir une ligne directrice simple pour comprendre comment les volumes et les intensités peuvent évoluer.
Mois 1 : Bâtir la fondation (volumes bas, intensité très faible)
Durant le premier mois, l’objectif est simple : (re)prendre un rythme stable, sans chercher à augmenter la charge. On pose les bases. On crée l’habitude. On installe la régularité.
Concrètement :
- 2 à 4 séances par semaine selon ton niveau et ton emploi du temps.
- Séances en endurance fondamentale uniquement.
- Une sortie un peu plus longue le week-end, mais toujours très douce.
- Aucune intensité, aucune côte rapide, aucune allure “tempo”.
Ce qui compte ici :
- retrouver des sensations de confort,
- apprendre à ralentir,
- terminer tes sorties en te sentant fraîche.
Ce premier mois doit être le plus simple et le plus apaisant possible. Tu construis les fondations.
Mois 2 : Augmenter progressivement le volume (+10 % par semaine)
Une fois que ton rythme est bien en place, tu peux augmenter légèrement le volume. L’important est que cette progression reste douce : +10 % par semaine est un repère courant, mais pas obligatoire. L’idée est d’allonger un peu les séances, pas de doubler ton entraînement.
Concrètement :
- tu gardes la même structure que le mois 1,
- tu augmentes un peu :
- la durée de ta sortie longue,
- ou le nombre total d’heures/km sur la semaine,
- mais toujours dans des proportions raisonnables.
- l’intensité reste majoritairement très faible.
Cette phase est essentiel, car ton corps commence réellement à s’adapter : cœur, muscles, respiration, énergie… tout devient progressivement plus efficace. Ce mois est celui qui apporte le plus de bénéfices visibles à long terme.
Mois 3 : Introduire du tempo léger pour consolider
Après deux mois d’endurance très douce, tu peux ajouter un peu de “tempo” — pas de la vitesse, pas des intervalles, juste une intensité un peu plus soutenue qui reste confortable.
Objectif du mois 3 : rendre ton endurance plus solide, plus polyvalente et plus durable.
Concrètement, cela peut être :
- 10 à 20 minutes de tempo doux dans une sortie,
- un peu de travail en côte à intensité modérée,
- ou des blocs faciles du type 2 × 8 minutes plus soutenues mais contrôlées.
Le reste de tes séances reste en endurance fondamentale. Ce mois permet de stabiliser les adaptations du foncier et de préparer ton corps à des entraînements plus spécifiques au printemps, si tu le souhaites.
Surtout : Tu n’as aucune obligation d’introduire de l’intensité si tu ne le sens pas. Ce mois peut rester très facile aussi. La progression doit avant tout rester agréable.
Les types de séances incontournables pour améliorer son endurance
Pour développer une vraie base d’endurance — celle qui te permet de courir plus longtemps, plus confortablement et avec moins de fatigue — il n’existe pas mille secrets. Ce sont les séances simples, répétées régulièrement, qui font vraiment la différence.
Les sorties en endurance fondamentale
C’est le cœur du foncier. Ce sont ces sorties où tu pourrais discuter sans être essoufflée, où tes jambes tournent tranquillement, sans jamais forcer.
Elles sont essentielles car :
- elles améliorent l’efficacité du cœur,
- elles renforcent toute la mécanique énergétique,
- elles construisent une endurance profonde et durable,
- elles limitent le risque de blessure.
Pour être en endurance fondamentale, il te faudra accepter de ralentir… de vraiment ralentir. Tu ne cherches pas la performance et tu restes dans une intensité vraiment basse (FC, RPE ou simple feeling).
C’est le type de séance où “moins vite” signifie “se construire mieux”.
Les footings / sorties longues
La sortie longue est la version “un peu plus étirée” de l’endurance fondamentale. C’est elle qui t’habitue à rester en mouvement plus longtemps, sans te cramer.
Les sorties longues te permet :
- d’améliorer ta capacité à utiliser les graisses comme carburant,
- d’être plus résistante à la fatigue,
- de travailler ton endurance mentale.
Pas besoin de faire 2 heures : l’important, c’est la régularité, pas l’exploit. Commence court et augmente de 5-10 minutes toutes les semaines. Et surtout, maintiens un rythme confortable tout du long.
Le travail en côte à faible intensité
Les côtes donnent un boost énorme à l’endurance… même sans aller vite. Le travail en côte à faible intensité est souvent sous-estimé, mais c’est un allié précieux.
Pourquoi ça fonctionne :
- sollicitation musculaire plus importante sans accélérer le cardio,
- meilleure posture (tu te redresses naturellement),
- renforcement des chaînes musculaires utiles en course à pied.
Selon ton niveau, marche ou trottine doucement dans les montées. Surtout, reste dans une intensité facile et utilise les descentes pour relâcher.
Le renforcement musculaire spécifique (gainage, proprioception)
L’endurance ne se joue pas que dans le souffle : elle se construit aussi dans les muscles.
Le renfo permet :
- de stabiliser la foulée,
- d’éviter les blessures,
- de mieux “tenir” en fin de sortie,
- d’être plus efficace à chaque appui.
N’oublie pas d’intégrer du gainage (anti-rotation, planche, side plank), des exercices pour de la bas du corps (fentes, squats, ponts de hanches), et de la proprioception (équilibre, travail sur une jambe). 5 à 15 minutes, une à deux fois par semaine, suffisent largement pour faire une vraie différence.
Les séances de cadence / technique (cyclistes + coureurs)
Ces séances servent à améliorer l’économie de mouvement : courir ou pédaler plus efficacement, avec moins d’énergie gaspillée.
Pour les coureuses :
- éducatifs (montées de genoux, talons-fesses, skipping),
- foulée légère et cadence légèrement augmentée (sans sprinter).
Pour les triathlètes / cyclistes :
- séance de vélocité (pédaler très souple, cadence élevée, faible résistance),
- travail de technique (posture, trajectoire, fluidité).
Ces exercices ne sont pas “physiquement durs”, mais ils améliorent énormément la qualité globale de ton endurance.
Comment mesurer les progrès pendant la période de foncier
L’endurance se construit lentement, parfois tellement progressivement qu’on a l’impression de ne pas avancer. Pourtant, si tu observes les bons indicateurs, tu verras que les petites améliorations se cumulent… et qu’elles finissent par faire une vraie différence.
Tests simples (endurance, aisance respiratoire, vitesse en EF)
Pas besoin d’un laboratoire ni d’un test compliqué. Quelques repères faciles suffisent pour voir si ta base d’endurance s’améliore.
1. Le test d’aisance respiratoire
Choisis un footing en endurance fondamentale et demande-toi : Est-ce que je parle plus facilement qu’il y a un mois ? Si la réponse est oui, tu progresses.
2. La sortie “repère”
Fais régulièrement la même boucle (30 à 45 minutes), au même ressenti. Avec le temps, tu constateras soit une allure légèrement plus rapide, soit une sensation de moindre effort.
3. La vitesse en EF
Si tu mesures ta fréquence cardiaque, tu verras qu’à intensité égale, ton allure s’améliore naturellement. Pas besoin de viser la vitesse : elle vient d’elle-même quand la base d’endurance devient solide.
Suivre la fréquence cardiaque au repos
C’est un indicateur simple, fiable et très révélateur. En effet, une fréquence cardiaque au repos plus basse montre que ton cœur devient plus efficace. Cela permet de repérer les périodes de fatigue. Il s’agit d’un excellent marqueur d’adaptation à l’entraînement.
Comment faire :
- mesure-la le matin, avant de te lever,
- compare semaine après semaine plutôt que jour par jour,
- observe les tendances, pas les chiffres isolés.
Une diminution même légère (1 à 5 battements) sur plusieurs semaines est un super signe.
Amélioration du ratio allure / intensité
C’est l’indicateur qui résume tout : si ton allure augmente alors que ton intensité reste basse, ton endurance progresse.
Tu peux l’observer de plusieurs manières :
- tu cours plus vite en EF
- tu tiens plus longtemps à la même allure sans t’essouffler
- ta fréquence cardiaque monte moins vite qu’avant
- tes jambes fatiguent moins tôt
Ce ratio est précieux parce qu’il montre l’amélioration de ton “rendement énergétique” : tu dépenses moins d’énergie pour produire le même effort.


Les erreurs les plus courantes en construisant une base d’endurance
Aller trop vite (l’erreur n°1)
C’est l’erreur la plus répandue, et franchement, elle est très humaine : marcher (ou courir) lentement alors qu’on sait aller plus vite, ça demande de l’humilité et un peu de patience.
Trop d’intensité brouille le message que tu veux envoyer à ton corps, tu consommes beaucoup de glucides au lieu de travailler l’endurance, tu rends chaque sortie plus fatigante que nécessaire. Résultat : tu risques de te cramer avant d’avoir construit quoi que ce soit.
Pour l’éviter, repère l’allure qui te permet de parler aisément. Contrôle ton égo, surtout au début. Rappelle-toi que lentement ne veut jamais dire inutilement. C’est au contraire le terrain sur lequel l’endurance profonde se construit vraiment.
Augmenter le volume trop rapidement
Quand la motivation est là, on a parfois envie de tout envoyer : plus de séances, plus longues, plus souvent… Mais le corps n’aime pas les accélérations brusques.
Ce qui se passe si tu montes trop vite :
- fatigue accumulée,
- baisse de motivation,
- risques de blessure (tendons, genoux, mollets),
- stagnation parce que les adaptations ne suivent pas.
Pour éviter cela, augmente le volume de 5 à 10 % par semaine, garde une semaine allégée toutes les 3 ou 4 semaines et reste à l’écoute des sensations. Si tu sens que tu as fait “trop”, ce n’est pas grave : tu peux réduire la semaine suivante. Le foncier, c’est du long terme.
Négliger la récupération hivernale
L’hiver est une période idéale pour construire de l’endurance… mais seulement si tu laisses à ton corps la place de récupérer. En effet, la récupération est le moment où ton corps assimile vraiment le travail. Elle permet d’éviter la fatigue de fond qui traîne tout l’hiver et aide à rester motivée quand les jours sont courts et froids.
Surveille la qualité de ton sommeil (vraiment essentiel), les températures extérieures (le froid peut fatiguer davantage que ce qu’on pense)… Mais aussi à avoir une alimentation suffisante pour soutenir les volumes.
Une séance sautée parce que tu es fatiguée n’est pas un échec. C’est parfois ce qui te permet de tenir le reste du programme sereinement.
Oublier la régularité (le vrai secret de la progression)
On l’oublie souvent, mais la régularité bat largement l’intensité et les grosses semaines isolées. En effet, elle permet au système cardiovasculaire de progresser semaine après semaine, tout en posant des repères pour ton corps. Elle rend l’endurance plus naturelle, moins exigeante. Et permet d’éviter les cycles “je m’y remets / je perds tout / je recommence”.
Concrètement, il vaut mieux 3 petites séances régulières que 1 grande séance de temps en temps. Même 25 à 30 minutes en EF comptent. Une progression lente mais stable fait des merveilles.
La base d’endurance, c’est comme planter un arbre : il ne pousse pas en le tirant vers le haut. Il pousse parce que tu l’arroses régulièrement, calmement, sans impatience.
Conclusion : une base d’endurance solide pour performer au printemps
Construire une base d’endurance pendant l’hiver, c’est investir dans tout ce qui rendra ta saison plus fluide : un cœur plus efficace, des sorties plus agréables, une meilleure résistance à la fatigue et un corps prêt à soutenir la charge quand arriveront les entraînements spécifiques. En prenant le temps de poser ces fondations entre novembre et février, tu t’offres un vrai confort pour la suite : tu progresses sans stress, tu gagnes en confiance, et tu abordes le printemps avec une endurance profonde, stable, durable.
L’essentiel tient en trois points : avancer à ton rythme, rester régulière et privilégier la basse intensité. Ce sont ces habitudes simples, répétées semaine après semaine, qui feront toute la différence quand tu commenceras à préparer tes objectifs.
Et si tu veux être accompagnée pour structurer ton hiver sereinement, tu peux utiliser mon code MARGAUXLIFESTYLERUN pour profiter d’un mois gratuit chez Campus Coach et poser les bases avant d’attaquer la préparation du printemps.
Quel est ton prochain objectif en course à pied ? Plus d'endurance ou plus de vitesse ?
Si tu aimes cet article, épingle-le ! ⬇️
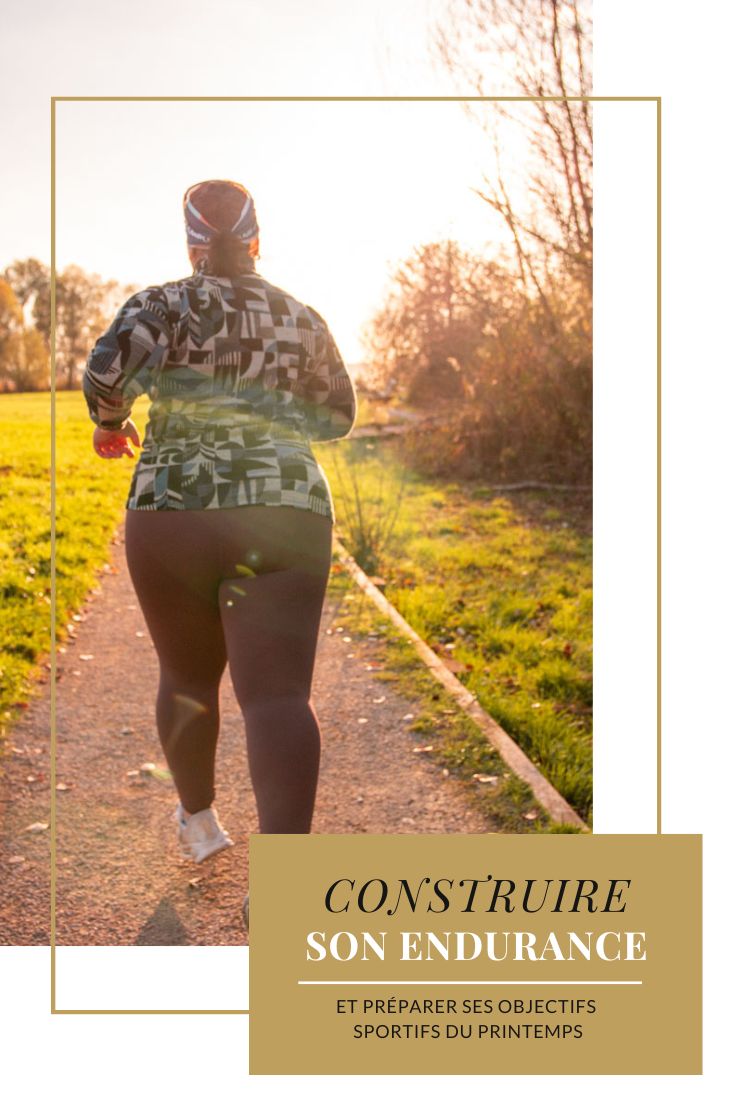

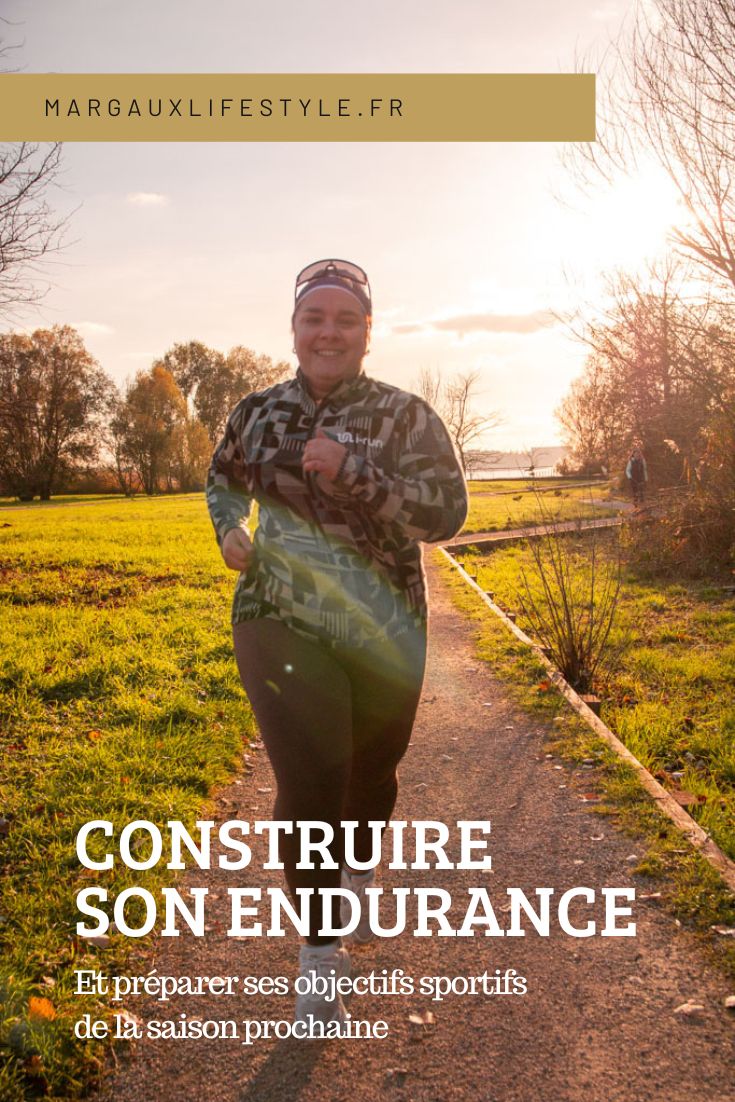
Ne t'arrête pas ici !
